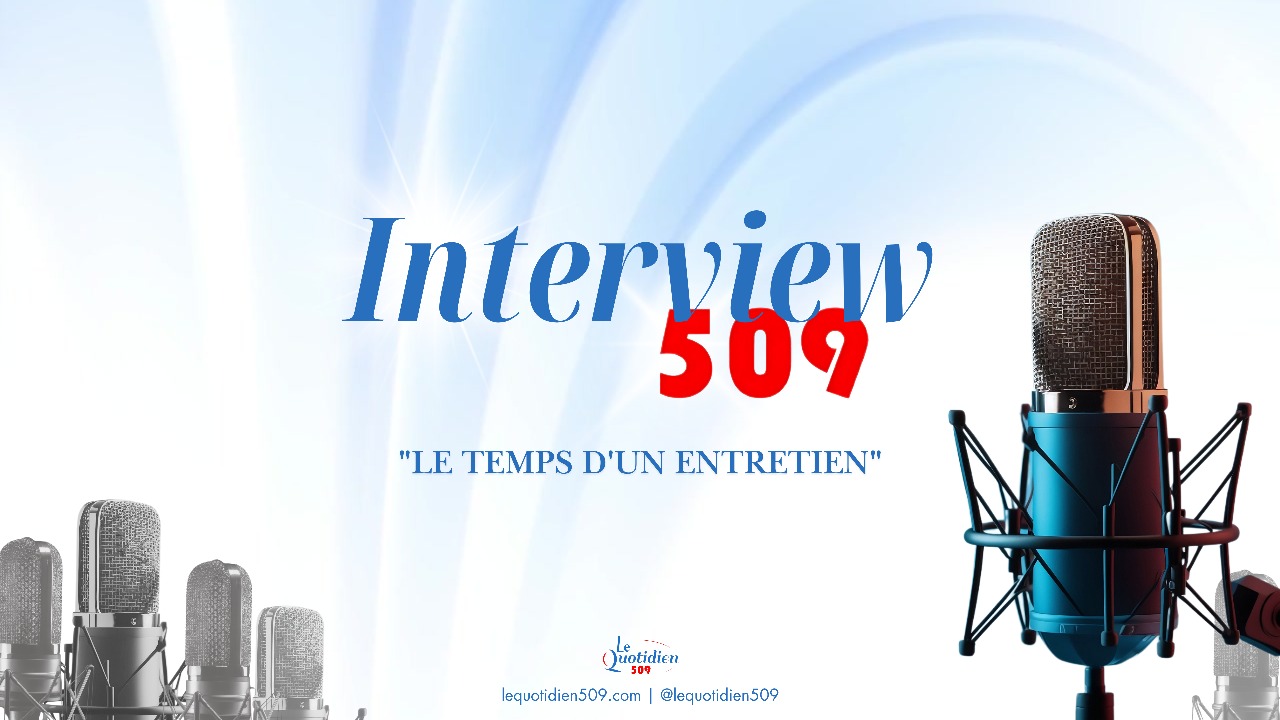Le mois de novembre dernier a marqué le deuxième anniversaire des sanctions canadiennes contre les membres des élites économiques et politiques d’Haïti. Profitant de la résolution 2653 (2022) des Nations unies, qui avait sanctionné uniquement Jimmy Cherizier alias « Barbecue » le 21 octobre 2022, le Canada a décidé de doubler l’ONU en sanctionnant, à l’avance, certains membres des élites économiques et de la classe politique.
Des bandits notoires, cruels et violents qui se sont déclarés dans la presse locale et internationale sont aussi catégorisés comme appartenant à l’élite haïtienne et l’on retrouvera des hommes d’affaires à côté de ces puissants chefs de gangs sanctionnés aussi pour violence sexuelle. Quel coup de massue à notre société ! Quelle entaille profonde pour l’histoire d’Haïti ! Où est la Diplomatie Haïtienne ?
Le Canada a sanctionné en tout 31 Haïtiens. Novembre 2024 : deux ans de sanctions et deux ans depuis que ces personnes sanctionnées attendent que leur soit soumis le dossier comportant les faits et les preuves les incriminant. Paradoxalement, deux ans depuis que la situation a empiré dans le pays, malgré les sanctions.
Les États-Unis ont appliqué aussi des sanctions à travers le Département du Trésor et l’OFAC à certaines personnalités politiques du pays et révoqué le visa de plusieurs personnes et membres de leur famille en toute discrétion.
L’Ambassade de France en Haïti, sous la diligence de Fabrice Mauriès, en dépit de la déclaration de ce dernier disant attendre les sanctions de l’ONU et de l’Union Européenne, a décidé elle-même d’abroger certains visas Schengen et Dom-Toms.
La République Dominicaine a abrogé les visas et déclaré persona non grata plus d’une trentaine d’haïtiens. Sa liste mentionne tous les chefs de gangs reconnus comme tels en Haïti, des hommes politiques, des professionnels, des membres de l’élite économique et même des représentants d’organisme de droits humains. Le Premier Ministre Ariel Henry, avec qui les sanctions ont démarré, a été lui-même déclaré persona non grata par le président Luis Abinader pendant son avion était en route vers la République dominicaine à destination d’Haïti. Qu’a dit là encore la diplomatie ? Quel est le dossier de l’Ex-PM Henry qui, jusqu’à date, n’a jamais pu rentrer dans le pays suite à un voyage diplomatique?
De son côté, les Nations unies ont sanctionné certains chefs de gangs reconnus comme tels par la société et un ancien député.
Le citoyen lambda se demande pourquoi certains chefs de gangs et même des personnalités reconnues par tous n’ont-ils jamais été sanctionnés par le Canada ? Cependant, l’ex-ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière avait fait comprendre dans une lettre ouverte que les sanctions sont un outil pour créer un climat de pression directe.
“Les sanctions ont créé un climat de pression directe sur les membres de l’élite pour qu’ils aident à la résolution de la crise – car il existe toujours une possibilité que des sanctions supplémentaires soient imposées. »
Une stratégie qui a son revers, on peut dire, car dorénavant, ceux qui ont toujours aidé à prévenir les crises ou à les gérer ont décidé de se museler de peur de se faire sanctionner ou d’être associés à quelqu’un qui a été sanctionné. À se demander si cette descente aux enfers que la société haïtienne subit chaque jour n’est pas due aussi à cette stratégie qui indirectement crée une peur au niveau des acteurs politiques et économiques capables réellement d’aider à solutionner la crise. Fermons cette parenthèse (…).
Cependant, les États-Unis permettent à la personne sanctionnée de se défendre, les Nations unies ont fixé les sanctions pour un an, renouvelable au gré du Conseil de sécurité, l’Union Européenne a dans ses règlements prévu aussi une durée renouvelable avec la possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des observations sur son dossier évoqué par le comité des sanctions, la France permet aux personnes dont les visas ont été abrogés de faire recours auprès du Tribunal de Nantes.
Toutefois, le Canada, comme pays dit d’Etat de Droit, n’a pas la même flexibilité malgré le délai de trente (30) jours prévu dans ses règlements pour permettre aux victimes de contester et de solliciter le dossier les incriminant.
D’après les textes légaux, tant que le gouvernement canadien a des “raisons de croire” qu’une personne, et non une autre, mérite d’être sanctionnée, son nom sera porté sur la liste et pour une durée indéterminée, nonobstant les violations des droits de l’homme, la précarité de vie à laquelle cette personne est soumise et le caractère arbitraire et inhumain de l’opprobre subi dans sa vie quotidienne.
Chassées des systèmes bancaires, ces personnes se trouvent bien souvent dans l‘impossibilité de recevoir tout montant leur permettant de subsister ou de payer des redevances telles que dettes d’honneur, loyer, soins de santé, factures diverses, etc… (Fermons encore cette parenthèse).
Le sens de ce rappel du 2e anniversaire des sanctions en Haïti est de montrer combien Haïti a encore raté ou rate tout simplement la chance d’imposer une diplomatie forte, de combattre la corruption, de renforcer sa souveraineté nationale et de protéger ses concitoyens en regard du droit international et du caprice de certains pays.
En effet, les sanctions internationales et unilatérales, qu’elles soient politiques, économiques, diplomatiques ou ciblées, sont devenues des outils stratégiques majeurs dans les relations internationales.
En témoigne une analyse des cas du Venezuela, de la Chine, de la Russie, de Haïti, du Niger, et de Cuba, ainsi que l’inaction de l’État haïtien face aux injustices faites aux personnalités sanctionnées.
Cas pratiques :
1. Venezuela : Répression face aux sanctions
Le Parlement vénézuélien a adopté une loi punissant sévèrement (25 à 30 ans de prison) toute personne soutenant ou facilitant des sanctions internationales contre le régime de Maduro. Cette mesure vise à dissuader l’opposition et à renforcer le contrôle interne face à l’isolement international.
➔ Impact : Cela montre comment un État peut transformer les sanctions en outils de répression interne en criminalisant l’opposition.
2. Chine : Résistance stratégique
Sous le coup de sanctions pour des abus envers les Ouïghours et d’autres violations des droits humains, la Chine adopte des mesures de représailles contre les entreprises et entités occidentales impliquées, en les plaçant sur des listes de restrictions commerciales.
➔ Impact : Pékin combine ripostes économiques et diplomatiques pour protéger ses intérêts tout en limitant les effets de sanctions.
3. Russie : Isolement et résilience
En réponse aux sanctions économiques et financières massives imposées après l’invasion de l’Ukraine, la Russie a renforcé ses alliances avec des pays comme la Chine et l’Iran. Les sanctions occidentales ciblent des secteurs stratégiques (énergie, finance) mais n’ont pas encore provoqué de changements politiques significatifs.
➔ Impact : Moscou développe des circuits économiques alternatifs tout en renforçant sa propagande interne contre les sanctions.
4. Haïti : Opportunités inexploitées
Contrairement au Venezuela, l’État haïtien n’a pas activement travaillé pour obtenir les dossiers des personnalités sanctionnées par le Canada et d’autres pays pour corruption ou soutien aux gangs. Ces sanctions qui incluent des figures politiques influentes, si elles sont justifiées, seraient pourtant une opportunité pour renforcer l’État de droit en Haïti.
➔ Question : Pourquoi Haïti n’a-t-il pas engagé des actions pour exploiter ces informations, soutenir les enquêtes locales et renforcer ses institutions ?
5. Niger : Sanctions après le coup d’État
Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger ont ciblé le régime militaire après le renversement du président élu Mohamed Bazoum. Cependant, ces sanctions ont également affecté la population civile, rendant leur efficacité contestée.
➔ Impact : Les sanctions combinent pressions économiques et isolement diplomatique, mais peinent à provoquer un retour à l’ordre constitutionnel.
6. Cuba : L’embargo comme outil de pression
Depuis des décennies, Cuba fait face à un embargo économique des États-Unis, affectant gravement son économie. Bien que critiqué pour son impact humanitaire, l’embargo reste un levier majeur pour pousser La Havane à des réformes politiques, même si son efficacité est discutable.
➔ Impact : Cuba continue de résister grâce à un réseau d’alliances internationales et au soutien interne, bien que son économie reste fragile.
Pourquoi Haïti reste-t-elle passive sur les dossiers de sanctions ?
L’inaction de l’État haïtien sur les personnalités sanctionnées par le Canada tient d’une complaisance inacceptable vis-à-vis du Canada. On peut relever :
• Manque de volonté politique : Les dirigeants actuels pourraient éviter d’agir pour protéger certains alliés ou par crainte de dévoiler des complicités.
• Opportunité manquée : Obtenir ces informations permettrait de renforcer les enquêtes locales et de montrer un engagement envers la lutte contre la corruption tout en renforçant les institutions républicaines.
Haïti pourrait suivre l’exemple de pays comme la Colombie, l’Afrique du Sud qui ont collaboré avec les sanctions américaines et d’autres pour renforcer leurs propres actions judiciaires, fixer les responsabilités et combattre l’apartheid.
Conclusion
Les sanctions internationales et unilatérales sont des outils complexes aux effets variés selon les contextes. Tandis que certains pays résistent ou ripostent, d’autres, comme Haïti, évitent d’exploiter ces mesures pour protéger au besoin leurs citoyens, renforcer leurs systèmes de gouvernance et leur crédibilité internationale.
L’inaction haïtienne face aux SANCTIONS montre surtout la nécessité d’un leadership plus engagé pour transformer ces défis en opportunités et rendre moins fragile la communauté haïtienne face au comportement léger de certains pays.
La rédaction
Le texte a été amélioré
📲 Rejoignez Le Quotidien 509
Recevez nos dernières nouvelles directement sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.
🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp