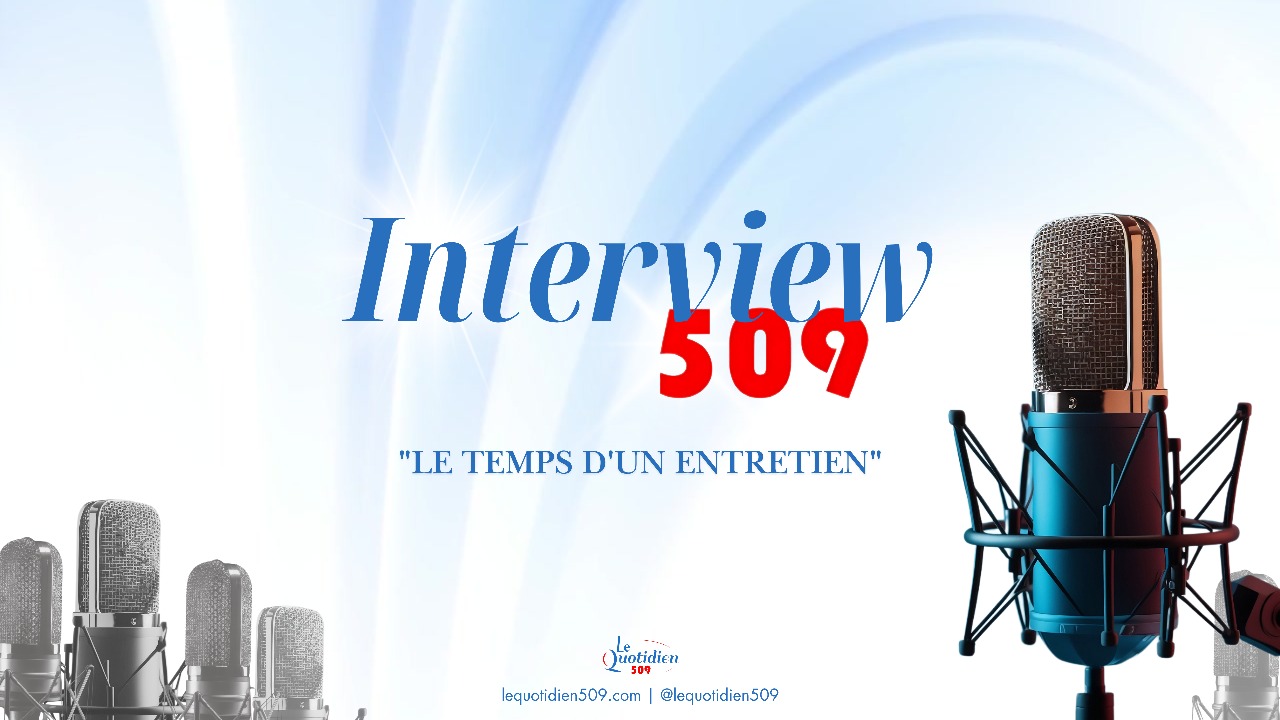Un déploiement kényan en Haïti : Quand les promesses se heurtent à la réalité
Un article publié le 6 décembre 2024 par Edwin Okoth à travers Reuters, relate la démission de vingt (20) policiers kényans, parmi les 400 déployés en Haïti, en raison de retards de paiement et de mauvaises conditions de travail. En guise de réponse, le chef de la police nationale kényane a affirmé que les troupes avaient été intégralement payées à la fin d’octobre, sans toutefois préciser la période couverte par ce versement.
A ce stade, une réflexion s’impose : ces soldats sont arrivés chez nous, sans grande préparation et semblent destinés à repartir de la même manière, sans un véritable impact positif sur le terrain et aussi, dans la plus grande indifférence de la population haïtienne qui ne sait toujours pas à nos jours, à quel saint se vouer, face à l’insécurité et aux violences des Gangs qui donnent chaque jour l’impression d’être plus actifs et redoutables.
Une rémunération contestée pour une efficacité questionnable
Le terme « salaire », dérivé du latin salarium, désigne une rémunération en échange d’un travail. Il peut aussi représenter une forme de rétribution morale. Cette définition m’interpelle lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact des troupes kényanes en Haïti.
Le bilan de leurs interventions soulève des interrogations. Ces policiers présentés comme des agents de paix, viennent d’un pays où, selon le journal Le Monde.fr, des forces de sécurité ont été accusées d’avoir tué au moins 50 manifestants et blessé 361 autres lors des protestations contre une loi fiscale en juin 2024. Ces violences nous forcent à nous demander : Mais qui sont ces policiers sélectionnés pour venir en Haïti et surtout, ont-ils été au moins contrôlés avant leur déploiement dans notre pays ? D’ailleurs, la Haute Cour du Kenya n’a t’elle pas jugé illégal le déploiement de policiers en Haïti?
Je me rappelle bien la fameuse mission de génocide de l’envahisseur espagnol, Christophe Colomb et des membres de son équipage qui étaient pour la plupart des repris de justice et qui ont fait le voyage à l’époque rien que pour s’en échapper.
Par ailleurs, selon le même article de Reuters, les troupes kényanes manquent de ressources pour faire face à la montée en puissance des gangs en Haïti. Un proverbe créole avertit : « Chyen mezire machwèl li avan li mòde zo » (Un chien doit mesurer ses dents avant de mordre un os).
Un contexte géopolitique aux multiples enjeux
Le Kenya, ancien protectorat britannique devenu colonie (1920-1963), a établi des relations diplomatiques avec les États-Unis en 1964, peu après son indépendance en 1963, tout en conservant des liens étroits avec son ancien colonisateur. Il convient également de souligner que les États-Unis entretiennent des relations privilégiées avec deux partenaires majeurs sur la scène internationale : le Vatican et la Grande-Bretagne.
En mai 2024, ces relations ont pris une tournure décisive lorsque la U.S. International Development Finance Corporation a annoncé des investissements majeurs au Kenya, portant ses engagements financiers à 1,1 milliard de dollars. Ce même mois, le président Joe Biden a marqué l’histoire en désignant le Kenya comme « allié majeur non membre de l’OTAN », une première pour un pays d’Afrique subsaharienne (source : Financial Times, RFI).
Ce statut stratégique a été consolidé lors de la première visite d’État du président kényan à Washington, au cours de laquelle, il a promis de sécuriser Haïti et de neutraliser les gangs responsables de souffrances indicibles (source : Le Point.fr).
Cependant, les résultats sur le terrain en Haïti contredisent tant de telles ambitions que la promesse même qui a été faite au « magicien » Biden, dans le cadre de cette chasse aux trésors géopolitiques qui façonnera l’économie des 20 à 30 prochaines années.
Un statut que l’ancien président américain Barack Obama, pourtant fils de Barack Obama Sr., né au Kenya dans le village de Kogelo, n’avait pas su accorder.
Moins d’un mois après avoir été accueilli en tant qu’allié privilégié le premier groupe, soit, le 25 juin 2024, un contingent de 400 policiers kényans a débarqué sur la terre de Dessalines, avec pour mission de soutenir la police haïtienne face à l’emprise croissante des gangs.
Un constat alarmant
Au moment de rédiger cet article, il est évident que la présence des policiers kényans n’a pas amélioré la situation sécuritaire en Haïti. Au contraire, elle semble avoir exacerbé les tensions, laissant la population haïtienne plus vulnérable que jamais. Les promesses publiques faites par les dirigeants kényans, et soutenues par leurs partenaires internationaux, peinent à se concrétiser.
En octobre 2024, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) en Haïti a atteint un niveau record de 702 973 individus, selon les données de l’UNHCR Data Visualization.
En septembre 2024, précisément 3 661 personnes ont été tuées (source : BINUH), soit un bond tragique comparé aux 2 505 victimes enregistrées au cours du premier trimestre 2024.
Des massacres ont marqué cette période, laissant des communautés entières dévastées :
30 juin 2024 à Gressier :
Au moins 20 résidents tués.
Octobre 2024 à Pont-Sondé :
Plus de 115 morts et 6 300 déplacés.
29 novembre 2024 à Léogâne (localité de Pedro, près de la 7ᵉ section communale des Pâques) : Au moins 14 morts et plusieurs blessés.
6 décembre 2024, au wharf de Jérémie, aucun bilan officiel n’a encore été communiqué, mais des medias en ligne font état de plus de 150 morts, brulés vifs.
Des infrastructures policières en ruines
30 juin 2024 : Reprise par les gangs, du commissariat de Saint-Charles, à Carrefour, pour la deuxième fois en moins de trois mois.
2 juillet 2024 : Destruction du commissariat de Saint-Charles.
30 octobre 2024 : Destruction du commissariat de Cabaret.
Paralysie économique et fermeture de l’Aéroport international
En novembre 2024, la situation sécuritaire a entraîné la fermeture de l’aéroport principal d’Haïti. Ironiquement, la base principale des troupes internationales déployées pour sécuriser le pays est située à proximité immédiate de ce même aéroport, soulignant un paradoxe inquiétant : l’incapacité des troupes kényanes à garantir la sécurité même autour de nos infrastructures stratégiques, mission pour laquelle, elles sont arrivées dans le pays.
En conclusion, cette mission illustre bien une dynamique complexe, mettant en lumière la quête de reconnaissance internationale d’un ancien colonisé de la Grande-Bretagne, cherchant à se positionner stratégiquement face à une autre grande puissance. Ce contexte s’inscrit dans une confrontation géopolitique ouverte autour des minerais rares, essentiels aux économies numériques et vertes.
Un détour par le Congo, riche en ressources minérales, révèle l’enjeu crucial de cette bataille : deux projets ferroviaires concurrents se disputent l’accès à ce que l’on pourrait qualifier de « trésor d’Alibaba ».
Ces richesses stratégiques, indispensables pour l’innovation technologique et énergétique mondiale, illustrent la toile de fond de cette rivalité.
Il faut néanmoins reconnaître au président kényan, une habileté remarquable à saisir les opportunités, atout stratégique pour inscrire son pays dans ce jeu d’échecs global.
Par ailleurs, cette mission s’inscrit également dans une ville où “The Prince’s Foundation”, la fondation du prince Charles d’Angleterre, a collaboré avec l’architecte Duany Plater-Zyberk (DPZ), bras technique basé à Miami, pour concevoir un ambitieux plan de reconstruction de Port au prince. Ce projet, visant 25 blocs représentant une surface de 2 000 hectares, devait revitaliser certains des plus anciens quartiers de Port-au-Prince, allant du Marché en fer jusqu’au bord de mer .
(source : Le Nouvelliste).
Il est important de souligner que l’État haïtien avait versé 295 000 dollars américains à cette organisation pour l’élaboration de ce plan, en septembre 2010 .
(source : AyiboPost).
Aujourd’hui, il apparaît évident qu’Abinader, animé par une obsession pour le projet d’unification de l’île, excelle dans son rôle en renforçant ses liens avec Ruto.
Le 19 septembre 2023, dans une démarche stratégique visant à préparer le terrain et garantir une longueur d’avance, le président dominicain Luis Abinader, inspiré par le proverbe créole « Konplo pi fò pase wanga, » a rencontré son homologue kényan William Ruto à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Au cours de cette rencontre, deux accords majeurs ont été signés : un Mémorandum d’Entente sur les Consultations Politiques et un Accord-Cadre de Coopération.
Ces documents ont été paraphés par les ministres des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Álvarez, et du Kenya, Alfred Mutua. La réunion tenue à huis clos, s’est déroulée dans les locaux de la Mission Permanente du Kenya auprès des Nations Unies. (Source: Rezonodwes)
Sa déclaration à la tribune des Nations Unies n’était peut-être pas une simple réflexion, mais bien une sombre prophétie annonçant l’effondrement d’Haïti, en commençant par l’effondrement de Port-au-Prince où les gangs sont alimentés constamment par des armes et des munitions vendues par de hauts gradés et des officiers de police dominicaine.
(Source: France Info)
Comment terminer cet article sans s’abandonner à cette profonde méditation porté par les paroles du chanteur reggae ivoirien, Tiken Jah Fakoly , dans son morceau sorti en 2005 :
“Plus rien ne m’étonne”…
Mais franchement, à bien y regarder, plus rien ne devrait nous étonner en effet. Rien. Si non que ces souffrances du peuple obligé toujours de fuir son pays, ici et là, de fuir son logement, pour aller crever parfois sous des tentes trouées où il pleut très fort, quand ce n’est pas tout simplement le soleil chaud qui leur fait grincer les dents, ce peuple continue de fuir éternellement sous des cieux hostiles. Il crie. Il se lamente. Il meurt. Il s’endort sous tant de bruits de balles chaque nuit où ce sont les étoiles en furie qui déchirent ses morceaux d’espoir.
Marnatha I. TERNIER
8 décembre 2024