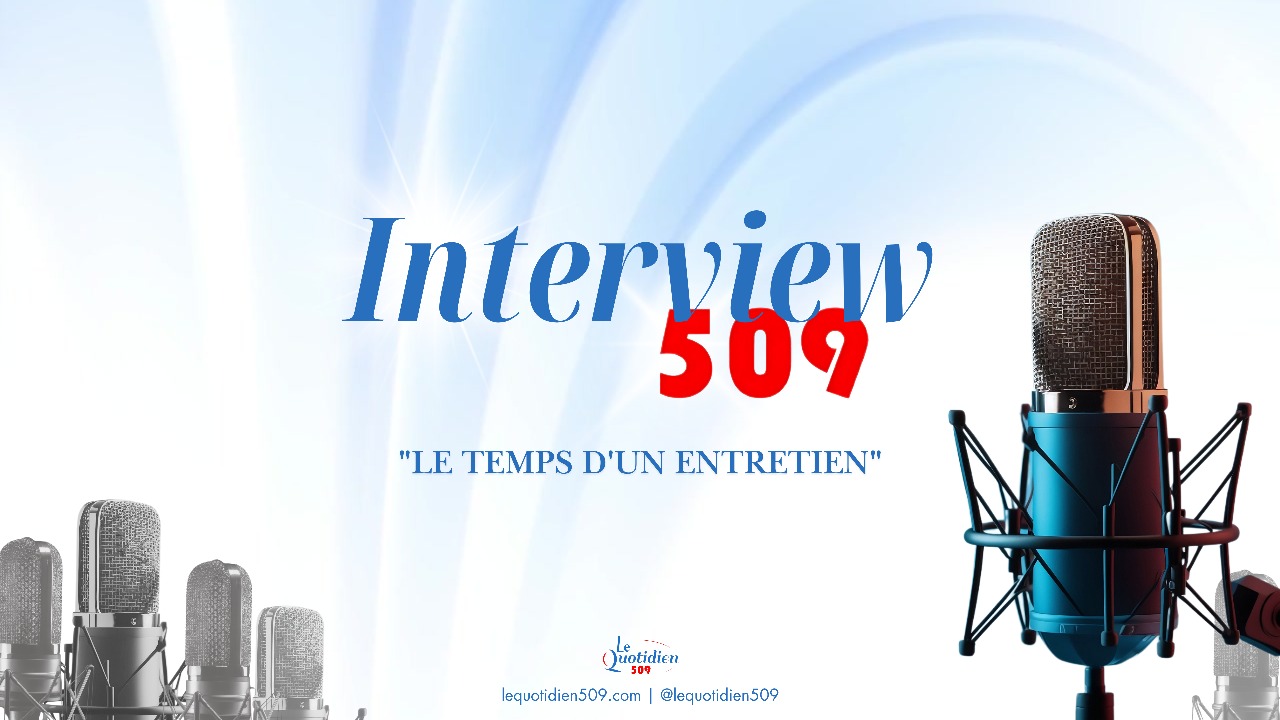Le 6 janvier 2025, sous pression du Parti libéral Canadien, le PM Justin Trudeau s’est retrouvé devant le fait accompli, après 9 ans au pouvoir. Il démissionne.
La départ de Justin Trudeau symbolisera aussi une époque où les relations entre le Canada et Haïti ont été caractérisées par des promesses non tenues et une aide inefficace. Cette période, marquée par des déclarations pompeuses et des engagements qui n’ont jamais donné de résultats concrets, a laissé Haïti dans une situation de plus en plus désastreuse, s’il ne faut pas se voiler la face.
Laurent Lamothe, ancien Premier ministre d’Haïti, a qualifié sur X la politique canadienne d’échec total. Il a rappelé les innombrables promesses non tenues du Canada, y “compris les 100 millions de dollars annoncés mais jamais décaissés, l’envoi d’un avion vers “nulle part”, des bateaux militaires qui sont restés sur le papier”, et des sanctions politiques sans fondement qui ont paradoxalement renforcé les gangs armés que le Canada voulait démanteler.
Les sanctions canadiennes contre des responsables haïtiens, dont Laurent Lamothe lui-même, ont commencé en 2022. Depuis lors, des personnalités politiques haïtiennes ont été frappées par des sanctions économiques et des interdictions de voyage, prises sans preuves concrètes présentées par le gouvernement canadien.
Un aspect crucial de ces sanctions a été le refus du gouvernement canadien de fournir les dossiers incriminant les personnes sanctionnées. Cette absence de transparence a alimenté la frustration et les critiques sur l’efficacité et la légitimité de ces mesures. Bien que n’ayant pas en mains une décision de justice, les banques haïtiennes, pour se mettre à l’abri, ont décidé de couper les relations d’affaires avec ces personnes en fermant par la même occasion les comptes en monnaie tant haïtienne qu’étrangère.
Un rapport publié en 2023, par la Fondation Droits Humains Sans Frontières du Chili a invité le Canada à respecter les droits des personnes qu’il a sanctionnées, tout en dénonçant la manière dont ces sanctions ont été appliquées. Elle a souligné que les sanctions, loin de contribuer à la stabilisation de Haïti, ont exacerbé les divisions politiques et renforcé les structures de pouvoir parallèles, notamment les gangs armés.
Pendant ce temps, Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, a annoncé que le Canada avait investi 400 millions de dollars en soutien à la sécurité en Haïti. Pourtant, malgré cet investissement, la situation en Haïti ne s’est pas améliorée et a même empiré. La crise des gangs, qui continue de dévaster le pays, est désormais un symbole de l’échec des politiques de soutien canadiennes et des partenaires internationaux.
Les sanctions, qui étaient censées être une mesure de pression pour le redressement, sont aujourd’hui devenues une plaisanterie amère pour les Haïtiens. Alors que le pays est confronté à une violence de plus en plus intense, le Canada, qui sollicite la coopération de certaines des mêmes personnes qu’il a lui-même sanctionnées, semble pris dans ses contradictions et ce n’est certainement pas Emmanuel Dubourg qui dira le contraire.
Ce double discours, où le Canada impose des sanctions tout en cherchant à collaborer avec ceux qu’il a isolés, reflète aussi l’incapacité de l’administration Trudeau à comprendre la dynamique politique complexe en Haïti. Les promesses de soutien à la sécurité et à la reconstruction ont été vaines, et la politique canadienne a échoué dans l’instauration d’un climat de stabilité en Haïti. Les Haïtiens, en particulier ceux qui vivent sous la menace des gangs, continuent de payer le prix fort de cet échec flagrant.
La rédaction
📲 Rejoignez Le Quotidien 509
Recevez nos dernières nouvelles directement sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.
🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp