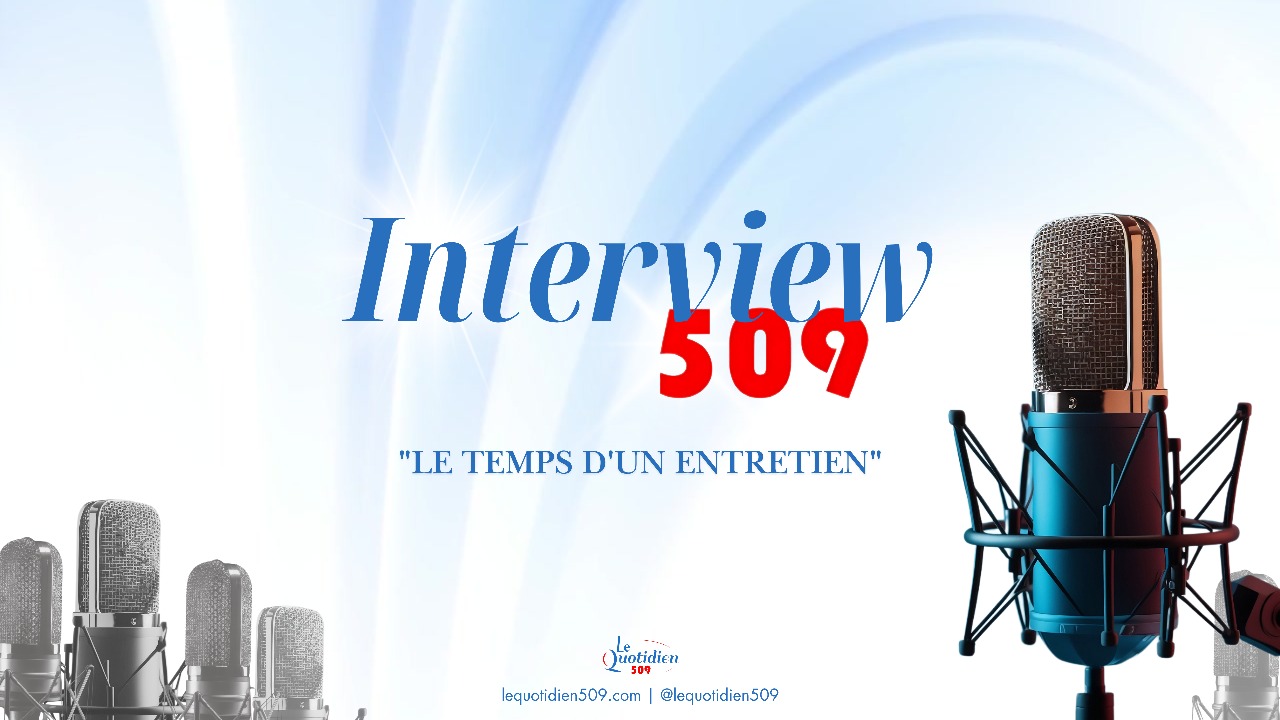Port-au-Prince / Montréal, 25 juillet 2025 – Dans une lettre ouverte adressée au Secrétaire d’Etat Américain Marco Rubio, le fils de feu Jovenel Moïse, Joverlein Moïse, relance l’appel à la justice pour l’assassinat de son père, quatre ans après les faits. Si la démarche se veut solennelle et empreinte de dignité, elle suscite aussi des interrogations de fond sur le changement brutal de ton adopté envers les États-Unis, acteurs pourtant centraux dans ce dossier à la fois judiciaire, diplomatique et géopolitique.
De l’accusation directe… au silence diplomatique
Dans ses premières sorties médiatiques, Joverlein Moïse n’hésitait pas à accuser nommément des agences américaines, telles que le FBI ou la DEA, d’avoir freiné l’enquête, ou encore d’avoir rapatrié précipitamment des suspects pour mieux les soustraire à la justice haïtienne. Il dénonçait aussi le manque de coopération de Washington dans la transmission des informations sensibles. Et pire l’accueil froid qu’il a reçu de l’ambassade Américaine en Haïti le 7 juillet 2021 pour reprendre ces propres dires.
Mais dans sa lettre du 23 juillet 2025, ce pan central du dossier est purement et simplement évacué. Plus un mot sur le rôle des institutions judiciaires américaines, aucune mention des obstacles diplomatiques ou juridiques rencontrés.
Un témoin-clé totalement ignoré
Un oubli d’autant plus flagrant qu’un élément crucial de l’affaire est également passé sous silence : l’unique témoin direct de l’assassinat, Martine Moïse, épouse du président défunt, se trouve actuellement aux États-Unis.
Des avocats du dossier affirment qu’elle ne peut pas rentrer en Haïti pour des raisons médicales, mais aussi pour des motifs liés à l’insécurité. Pourtant, elle n’est ni entendue par la justice haïtienne, ni mentionnée dans cette lettre ouverte qui se veut un plaidoyer complet pour la vérité.
Comment peut-on parler de “justice réelle” sans interroger ou solliciter la participation du principal témoin des faits ?
Des cibles judiciaires également réfugiées aux États-Unis
Plusieurs personnes recherchées par la justice haïtienne dans le cadre de l’enquête sont également réfugiées sur le sol américain. Certaines bénéficient d’un statut temporaire, d’autres sont sous protection discrète, selon des sources proches du dossier.
Malgré cela, aucune demande claire d’extradition ou de coopération judiciaire renforcée ne figure dans la lettre. Tout le focus est placé sur les “oligarques haïtiens”, définis comme les seuls responsables de la tragédie.
Une redéfinition des responsabilités : stratégie ou omission ?
Dans ce contexte, la sélectivité du discours de Joverlein Moïse interpelle. Son ton est désormais calibré, presque conciliant envers les États-Unis. Il s’adresse même au Secrétaire d’Etat Marco Rubio comme à un « allié historique », alors que ce dernier fait lui-même partie de l’élite politique conservatrice américaine, souvent assimilée à une forme d’oligarchie politique transnationale.
Pourquoi Joverlein Moïse devient-il en moins de deux semaines plus clément envers les États-Unis ?
Pourquoi exonérer aujourd’hui des institutions qu’il accusait hier, tout en renforçant le narratif anti-oligarchique local ?
Est-ce une stratégie d’alignement politique, un pari diplomatique, ou simplement un tactique d’internationalisation sélective du dossier ?
Une justice à géométrie variable ?
En réclamant une « justice réelle » tout en évitant de nommer ou d’interpeller certains acteurs clefs, Joverlein Moïse risque de perdre en cohérence et en crédibilité auprès d’une jeunesse haïtienne en quête de vérité intégrale. Car on ne peut, d’un côté, dénoncer une impunité systémique, et de l’autre omettre volontairement les zones grises de la machine diplomatique américaine.
Brigitte Benshow
📲 Rejoignez Le Quotidien 509
Recevez nos dernières nouvelles directement sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.
🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp