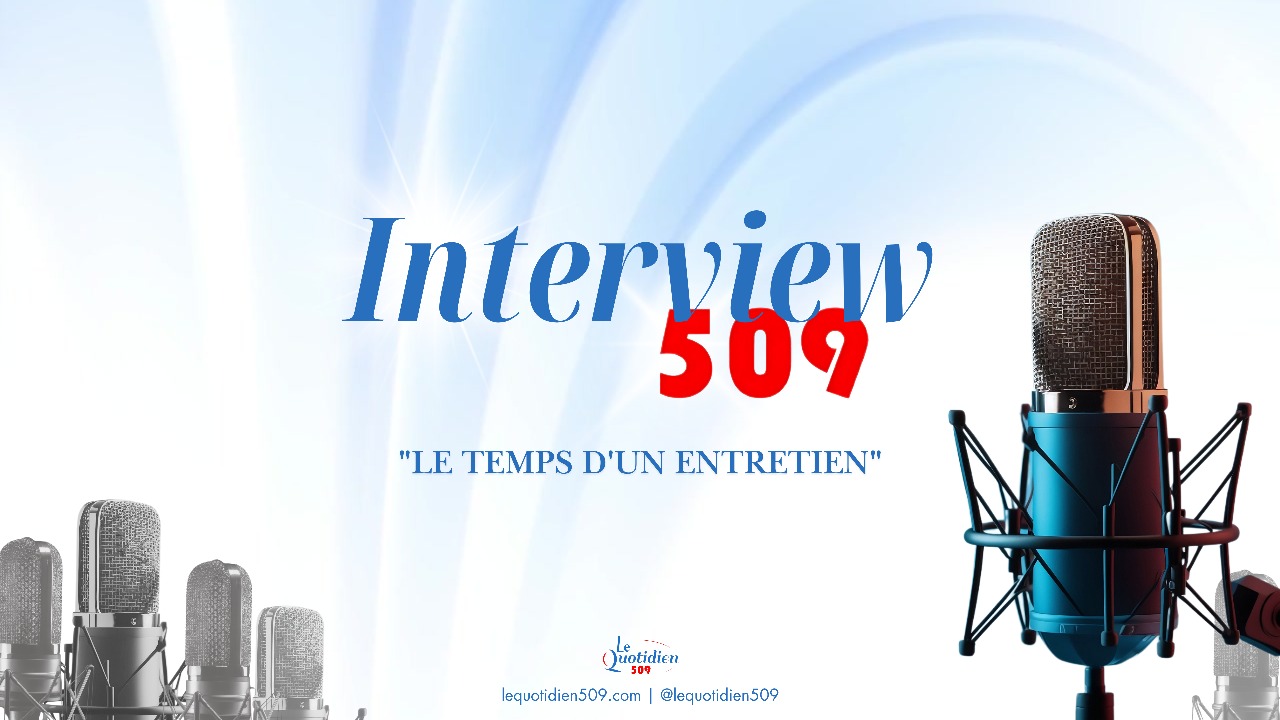Paris, 22 juillet 2025 – C’est désormais officiel : les États-Unis se retireront de l’UNESCO au 31 décembre 2026. Une annonce faite par la porte-parole adjointe du Département d’État, Anna Kelly, qui relance les tensions entre Washington et l’organisation onusienne chargée de la culture, de l’éducation et du patrimoine.
La Maison-Blanche, sous l’administration Trump, accuse l’UNESCO de biais persistants contre Israël, de promouvoir des causes jugées idéologiques et de se montrer partisane dans le conflit israélo-palestinien. Parmi les griefs : l’admission de la Palestine comme État membre en 2011, la désignation de sites juifs comme patrimoine palestinien, et l’adoption de politiques diversité-équité-inclusion (DEI) qualifiées de clivantes par l’exécutif américain.
« L’UNESCO est devenue une organisation qui soutient des causes déconnectées du bon sens des Américains », a lâché Anna Kelly.
Un retrait annoncé, mais préparé par l’UNESCO
La directrice générale de l’organisation, Audrey Azoulay, a réagi dans un communiqué empreint de fermeté et de regret.
« Je déplore profondément la décision du président Donald Trump. Elle va à l’encontre des principes du multilatéralisme et affectera avant tout nos nombreux partenaires aux États-Unis. »
Mais à l’UNESCO, cette décision n’est pas une surprise. L’organisation dit s’être préparée, tant sur le plan financier que structurel. Depuis le premier retrait américain en 2018, des réformes ont été engagées et le financement a été diversifié. Les États-Unis, qui représentaient autrefois 22 % du budget, n’en représentent aujourd’hui que 8 %.
Une rupture répétée
Il s’agit du troisième retrait américain de l’UNESCO. Après 1984 sous Ronald Reagan et 2018 sous Donald Trump, les États-Unis avaient fait leur retour en 2023 sous Joe Biden, avec l’intention de régler leurs arriérés de cotisations et de renouer avec le multilatéralisme culturel.
Mais la logique « America First » de Trump est revenue en force : ce nouveau retrait s’inscrit dans une révision plus large des engagements américains au sein des agences onusiennes, lancée début 2025. Elle cible notamment les entités jugées trop favorables à la Chine, ou insuffisamment alignées avec les intérêts de Washington et d’Israël.
Un bilan contesté
L’UNESCO défend son action. Elle rappelle avoir mené des projets d’envergure comme la reconstruction de la vieille ville de Mossoul, l’adoption du premier instrument international sur l’éthique de l’intelligence artificielle, et des programmes éducatifs dans les zones de guerre, en Ukraine, au Liban ou au Yémen.
Sur le terrain de la mémoire, l’agence insiste : elle est la seule entité onusienne dotée d’un mandat en matière de lutte contre l’antisémitisme et l’enseignement de la Shoah. Elle cite le soutien du US Holocaust Memorial Museum, du World Jewish Congress et de l’American Jewish Committee à ses programmes dans plus de 85 pays.
Washington dehors, mais pas coupé du dialogue
En dépit de la rupture institutionnelle, l’UNESCO entend maintenir la coopération avec les universités, les ONG et les entreprises américaines. Elle affirme qu’aucune vague de licenciement n’est prévue et qu’elle poursuivra ses missions.
« L’UNESCO reste la maison de toutes les nations. Les États-Unis y seront toujours les bienvenus », conclut Audrey Azoulay.
La rédaction