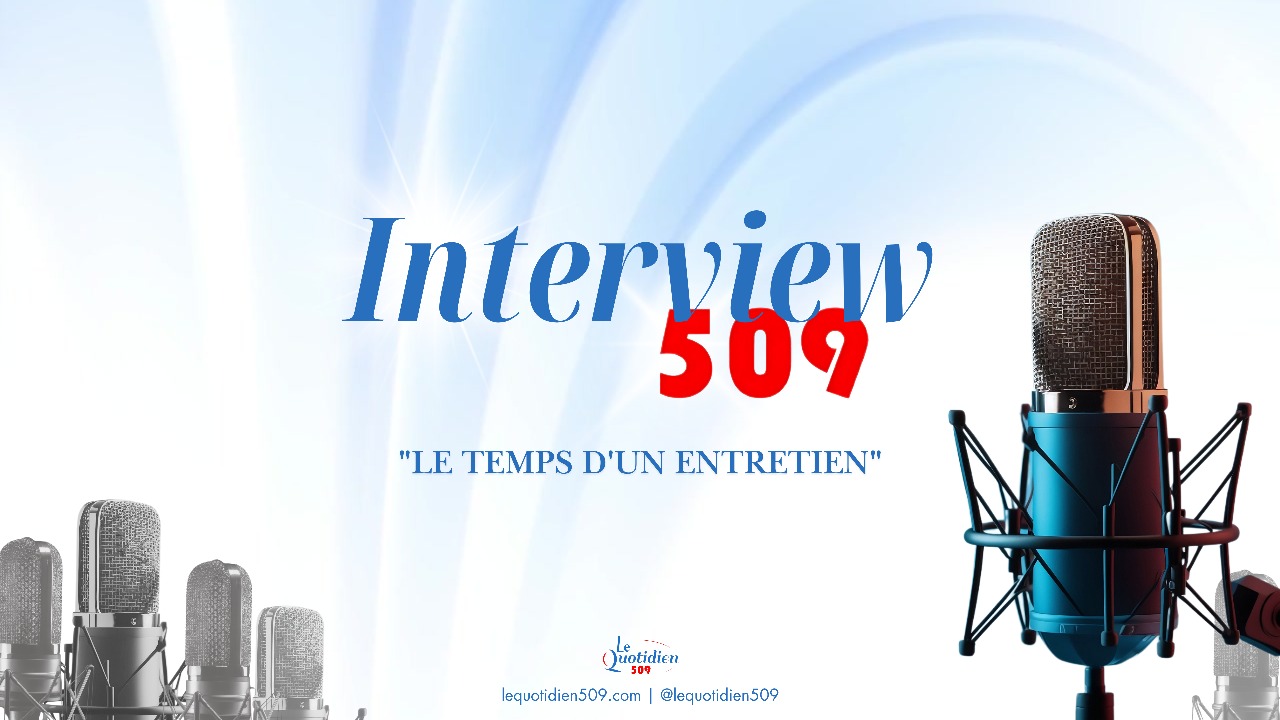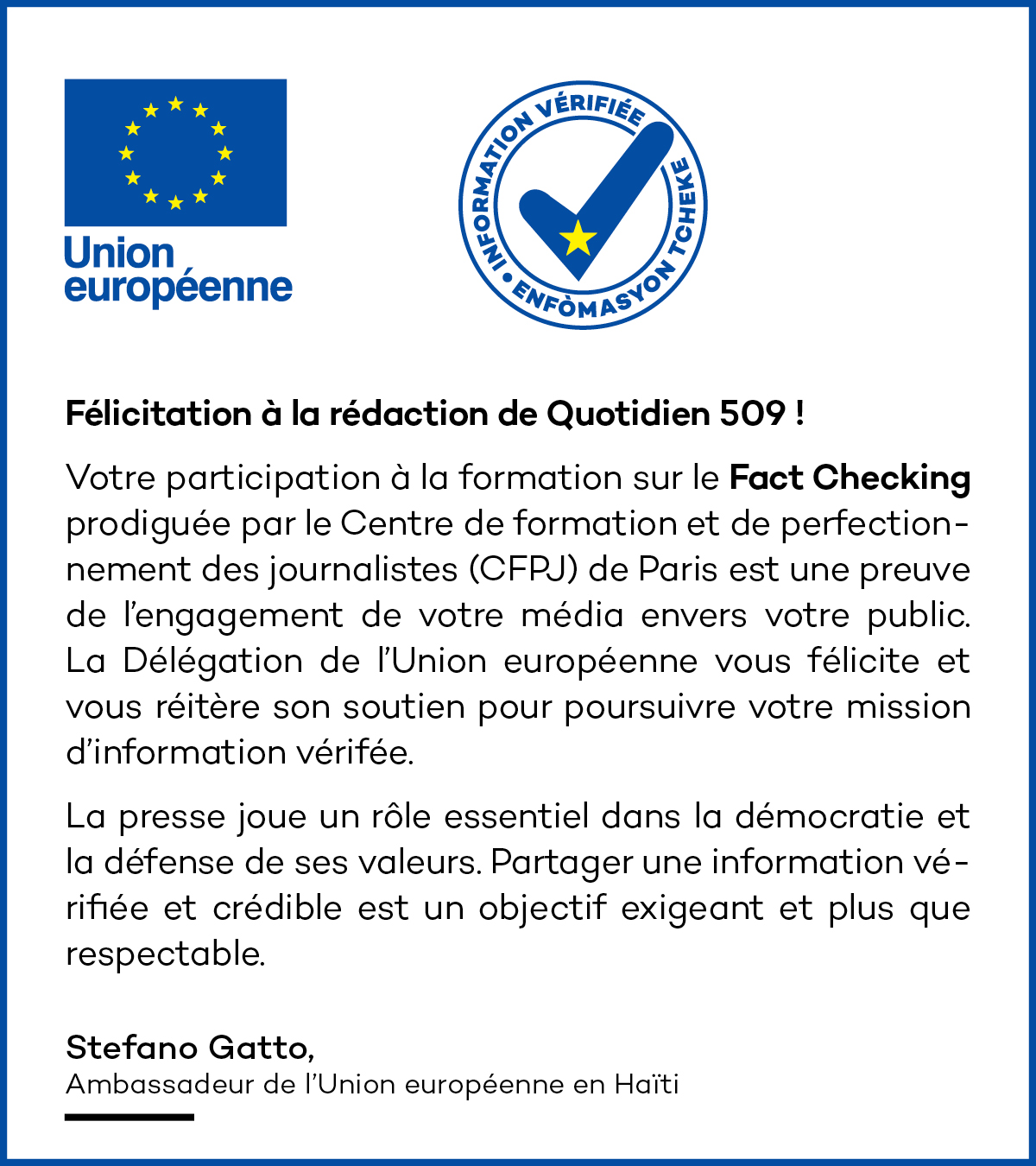Parmi la myriade de décrets signés par Donald Trump lundi 20 janvier, le président américain tout juste de retour à la Maison-Blanche a décidé de suspendre pour une durée de «90 jours» … «l’aide au développement étrangère des États-Unis pour évaluer l’efficacité des programmes et leur cohérence avec la politique étrangère des États-Unis».
«L’aide étrangère des États-Unis n’est pas alignée sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, est contraire aux valeurs américaines. Elles servent à déstabiliser la paix mondiale en promouvant dans les pays étrangers des idées qui sont directement opposées aux relations harmonieuses et stables au sein des pays et entre eux, a déclaré Donald Trump pour justifier cet ordre exécutif.
Conformément au décret du président Trump sur la réévaluation et la réorientation de l’aide extérieure des États-Unis, le secrétaire Rubio a mis en pause toute aide étrangère des États-Unis financée par ou via le département d’État et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en vue de son examen.
Ces récentes décisions de l’administration américaine concernant la réévaluation de l’aide américaine invitent à une profonde réflexion et incitent à une évaluation approfondie de certains fonds alloués à Haïti et de leur utilisation.
Une question cruciale se soulève : quelle a été l’efficacité des milliards de dollars d’aide alloués au pays depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010 ? Alors que des sommes colossales ont été promises et, dans certains cas, débloquées, le peuple haïtien continue de faire face à des conditions de vie critiques.
Des résultats limités par rapport aux promesses et dépenses
Lors de la conférence internationale des donateurs tenue le 31 mars 2010 à New York, 59 donateurs ont promis un total de 9,9 milliards de dollars pour soutenir le plan d’action national d’Haïti. Sur ce montant, 5,26 milliards de dollars étaient destinés à financer des projets spécifiques au cours des 18 mois suivants, dépassant ainsi les 3,8 milliards initialement sollicités. (Source UN).
Parmi les 87 projets approuvés pour un montant total de 3,26 milliards de dollars, seulement 37,2% des fonds promis par les bailleurs ont été décaissés d’après un rapport du 8 Avril 2011 de OCHA-Relief.
En 2024, l’Agence des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a lancé un appel de fonds de 674 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de 3,6 millions de personnes. Seulement 41 % des financements du Plan de réponse humanitaire sont couverts sur 674 millions, selon OCHA (source : OCHA Humanitarian Response Plan 2024).
Contributions des principaux donateurs
Les États-Unis
– Depuis 2010, les États-Unis ont investi plus de 5,1 milliards de dollars dans l’aide à Haïti, couvrant des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, l’infrastructure et l’agriculture (source : USAID Haiti).
– En 2024, l’USAID a annoncé une aide humanitaire additionnelle de 105 millions de dollars, portant le total à 211 millions de dollars pour l’exercice fiscal 2024 (source : Déclaration USAID 2024).
– Sur le plan sécuritaire, le département d’État a indiqué avoir débloqué plus de 350 millions de dollars depuis 2021 pour soutenir la Police Nationale d’Haïti (source : Antony Blinken 2024).
Le Canada
- Entre 2021 et 2024, le Canada a alloué 400 millions de dollars à des programmes de sécurité en Haïti (source : Gouvernement du Canada).
La France
- La France a contribué à hauteur de 10 millions d’euros pour la Mission Multinationale de Sécurité (MSS), montant destiné à l’apprentissage de la langue française, la formation policière et d’autres initiatives de sécurité (source : Ambassade de France en Haïti).
Nations Unies et Fonds Humanitaires
- Le Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) a alloué 18 millions de dollars en 2024 pour des initiatives humanitaires en Haïti (source : UN CERF 2024).
- Les budgets du BINUH et d’autres initiatives onusiennes atteignent des centaines de millions de dollars chaque année (source : Nations Unies Haïti).
Les appels de fonds de l’ONU pour Haïti ont été substantiels, avec des budgets alloués à divers projets humanitaires, y compris le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour les cantines scolaires, sans oublier le coût du Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).
Un paradoxe persistant
Malgré ces engagements financiers massifs, la situation reste critique :
- Infrastructures : Peu de progrès dans la reconstruction.
- Sécurité : L’insécurité, exacerbée par les gangs armés, paralyse le pays malgré des investissements massifs.
- Corruption : Des scandales comme PetroCaribe, avec 1,7 milliard de dollars détournés (source : Cour Supérieure des Comptes Haïti, 2019), illustrent les défis majeurs de gouvernance.
Qui contrôle l’aide reçue ?
Un des problèmes fondamentaux est le manque de transparence dans la gestion de l’aide :
- Les agences internationales, comme l’USAID ou l’OCHA, allouent des fonds directement à des ONG ou des agences d’exécution.
- Les rapports sur l’utilisation des fonds sont rarement publics, rendant difficile l’évaluation de l’impact réel (source : International Aid Transparency Initiative (IATI)).
La nécessité d’un audit transparent
Face à ces constats, l’Etat Haïtien devrait prendre ses responsabilités. Il faudrait un audit indépendant et exhaustif pour :
- Évaluer l’utilisation réelle des fonds : Quels montants ont été dépensés et pour quels résultats ?
- Identifier les failles : Gestion inefficace, corruption ou problèmes structurels ?
- Renforcer les institutions haïtiennes : Construire des capacités locales pour une meilleure gouvernance.
Vers une prise de responsabilité nationale
La réduction de l’aide américaine, bien que controversée, pourrait servir de catalyseur pour une introspection nationale. Il est impératif que les dirigeants haïtiens assument leurs responsabilités en matière de gouvernance et de gestion des ressources. La mise en place de structures pour des audits transparents, le renforcement des institutions de contrôle et une lutte effective contre la corruption sont essentiels pour assurer que les fonds, qu’ils soient d’origine nationale ou internationale, soient utilisés au bénéfice réel de la population.
En conclusion, l’afflux massif d’aide internationale en Haïti n’a pas non plus produit les résultats escomptés, en grande partie en raison de la mauvaise gouvernance et de la corruption. La décision de Trump offre une opportunité aux dirigeants haïtiens de repenser les mécanismes de gestion de l’aide afin qu’elle arrive effectivement aux bénéficiaires et de s’engager au-delà du grand mirage que constitue l’aide sur la voie d’un développement autonome et durable.
La rédaction