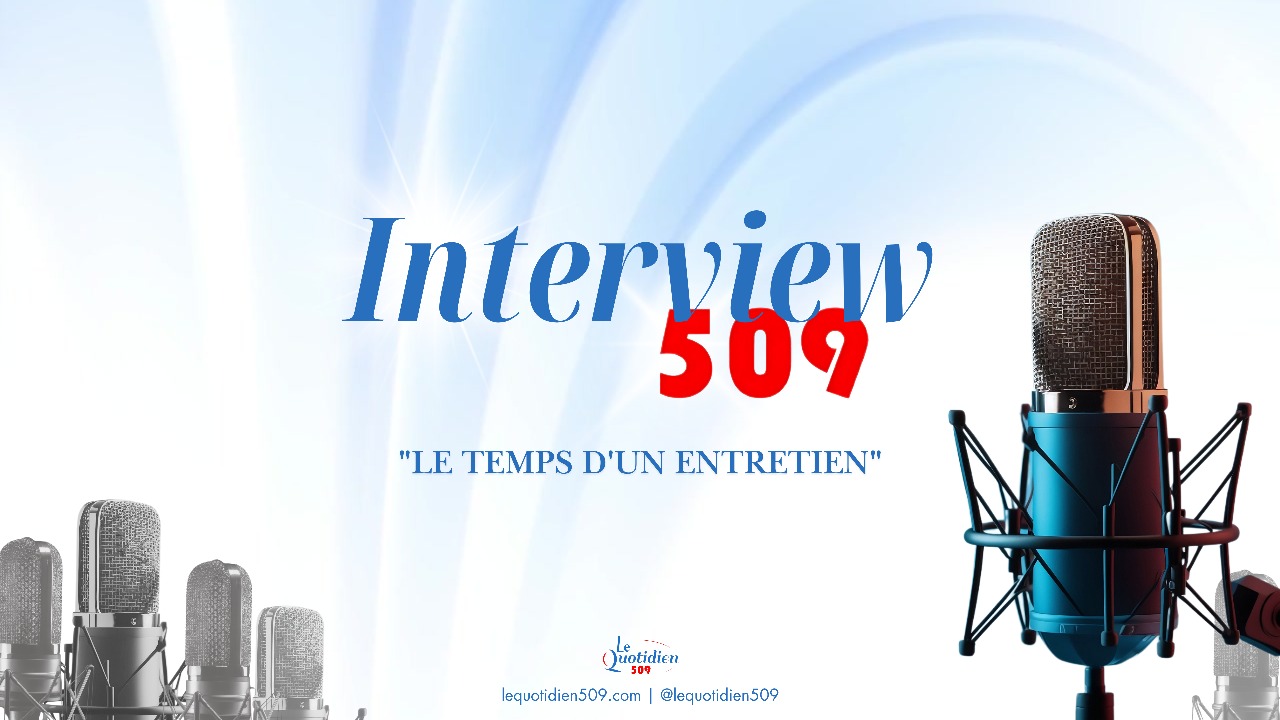Lors d’une session particulièrement tendue du Conseil de sécurité de l’ONU, ce 21 Avril 2025, consacrée à la crise en Haïti, les interventions ont mis en lumière l’ampleur dramatique de la situation sécuritaire dans le pays, mais aussi les profondes divisions entre puissances internationales sur les responsabilités et les solutions à envisager.
María Isabel Salvador, Représentante spéciale du Secrétaire général en Haïti, a averti que le pays risquait d’atteindre un « point de non-retour », évoquant l’isolement persistant de la capitale haïtienne, la réduction des opérations onusiennes à Port-au-Prince, et les dangers d’un sous-financement chronique. « Les forces de sécurité nationales ne peuvent réussir sans une structure de commandement unifiée et stratégique, libre de toute ingérence politique et opérant sous l’autorité civile » a-t-elle signalé.
Affirmant tout effort du gouvernement haïtien ne suffira pas pour réduire significativement la violence des groupes criminels, elle a jugé plus crucial que jamais d’intensifier le soutien international à Haïti, notamment par le biais d’un financement et d’une capacité opérationnelle accrus pour la MMAS. « Ce n’est pas un choix, mais une nécessité, car il n’existe aucune alternative viable ». lit’on dans le rapport du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Le délégué haïtien, Eriq Pierre, visiblement ému, a lui aussi dressé un constat alarmant, en déclarant : « La République d’Haïti est en train de mourir à petit feu sous l’action combinée des gangs armés, des narcotrafiquants et des trafiquants d’armes ». Appelant à une action décisive, il a déclaré : « Aux grands maux les grands remèdes », affirmant que le pays est prêt à soutenir toute initiative visant à éradiquer les gangs. « Les mettre hors d’état de nuire est une nécessité absolue », a-t-il martelé.
Du côté des partenaires, la France a confirmé son appui à une transition vers une opération de maintien de la paix. Elle a aussi annoncé la création d’une commission mixte franco-haïtienne, comme l’a annoncé Emmanuel Macron le 17 avril. Une décision saluée par la délégation haïtienne comme un pas vers des « espaces de dialogue et de compréhension mutuelle, dans une logique de réparation sans revanche », un sentiment partagé par la République dominicaine.
La République dominicaine a également plaidé en faveur de l’établissement d’une mission dotée d’un mandat offensif : « C’est le moment décisif pour une action coordonnée et une responsabilité partagée. »
Les A3+ (Algérie, Sierra Leone, Somalie et Guyana), soutenus par la Russie, le Panama et la France, ont rappelé que la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), actuellement déployée à seulement 40%, n’a pas la capacité d’accomplir pleinement son mandat. Ils ont appelé à envisager une opération de maintien de la paix de l’ONU à plus long terme.
Mais c’est la Chine qui a tenu les propos les plus virulents, accusant les États-Unis d’être le « cerveau » de la crise et de n’avoir fait qu’installer des autorités « marionnettes ». Pékin a dénoncé le fait que Washington ne respecte pas l’embargo sur les armes, laissant ainsi les gangs mieux équipés que la Police nationale d’Haïti.
« La Chine a invité la « nation souveraine » d’Haïti à former un gouvernement légitime sans délai et à cesser de compter sur l’aide systématique de l’étranger. La délégation s’est également lancée dans un réquisitoire contre les États-Unis, qu’elle a accusés d’ingérence de longue date dans les affaires haïtiennes. Après avoir orchestré, il y a un an, l’installation d’un nouveau gouvernement, Washington « ferme aujourd’hui les yeux, malgré le chaos », en n’appliquant pas réellement l’embargo sur les armes dont ils ont pourtant accepté l’imposition. « Le résultat, c’est que les gangs sont mieux outillés que la Police nationale d’Haïti », s’est inquiété le représentant chinois, notant que la plupart des armes arrivant en Haïti proviennent des États-Unis. » lit’on dans le rapport du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Les États-Unis, de leur côté, ont défendu leur action et rappelé qu’ils ne peuvent pas « porter seuls le fardeau », appelant les autres bailleurs de fonds à contribuer davantage aux efforts collectifs.
La rédaction
ONU